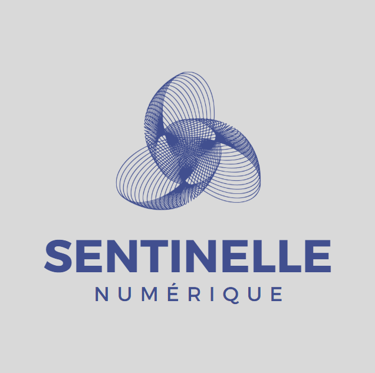ChatGPT, images générées et consommation d’eau : comprendre au-delà du buzz médiatique.
Faut-il s’inquiéter de la consommation d’eau liée à la génération d’images par IA comme ChatGPT ? Analyse rigoureuse pour démystifier les chiffres et repenser notre rapport à la technologie.
I.A
Oceane
4/14/2025


Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux et certains médias généralistes s’enflamment autour d’une affirmation devenue virale : "générer une image avec ChatGPT consommerait X litres d’eau », toujours dans de très hautes proportions. Cette phrase, aussi percutante qu’alarmiste, a été reprise, détournée et commentée à l’infini, jusqu’à devenir un raccourci sensationnaliste, souvent vidé de son contexte scientifique et technique. Derrière cette déclaration se cache une vérité bien plus complexe, qu’il est temps d’analyser avec rigueur.
La question de l’eau dans les centres de données : c’est un phénomène connu, mais nuancé. Les centres de données, qui font tourner l’intelligence artificielle, consomment effectivement de l’eau. Principalement pour le refroidissement des serveurs. Cela n’a rien de nouveau : depuis les débuts de l’informatique industrielle, cette consommation est une donnée intégrée dans la gestion énergétique des infrastructures numériques.
Mais une précision s’impose : l’eau utilisée ne correspond pas nécessairement à une "perte" dans le sens courant. Une part importante de cette eau est réutilisée, recyclée ou intégrée dans des circuits fermés. Par ailleurs, la plupart des grands opérateurs de cloud computing (Microsoft, Google, Amazon) investissent massivement dans des solutions innovantes visant à minimiser, voire compenser leur empreinte hydrique.
Alors d’où vient ce fameux « X litres par image" ? Il s’agit d’une estimation extrapolée à partir de données brutes sur la consommation totale de ressources associées à des modèles d’IA, souvent sur des périodes de plusieurs mois et des volumes de requêtes colossaux. Ramener ces chiffres à une seule image générée est une simplification abusive, qui ne rend pas compte de la réalité systémique du fonctionnement de l’IA.
Une comparaison biaisée : à quoi compare-t-on cette consommation ?
Pour juger de l’impact réel d’une technologie, il faut la comparer à d’autres activités humaines. Une recherche Google, une heure de streaming vidéo, une impression papier, ou encore la fabrication d’un smartphone, sont toutes des actions qui consomment elles aussi de l’énergie et des ressources, souvent bien supérieures à ce que suppose une interaction ponctuelle avec une IA.
Mais ces comparaisons, justement, manquent cruellement dans les discours qui dénoncent l’IA générative comme un "fléau environnemental". Pourquoi ? Parce que l’IA, en tant que technologie émergente, cristallise à la fois les peurs, les fantasmes et les projections idéologiques. Elle est le miroir d’une société fortement tiraillée entre l'innovation et la culpabilité écologique, ou entre la fascination et le rejet du progrès.
Une écologie technologique à construire, et non à diaboliser.
Ce que révèle ce buzz autour de l’eau, ce n’est pas tant un scandale écologique qu’un déficit de compréhension globale. Oui, les outils d’IA consomment des ressources. Comme toute technologie. Mais ils peuvent aussi, s’ils sont bien utilisés, contribuer à réduire drastiquement les gaspillages dans d’autres domaines : agriculture de précision, prévision climatique, gestion des réseaux électriques, modélisation d’épidémies ou encore conception de matériaux durables. La vraie question n’est donc pas de savoir combien d’eau consomme une image générée, mais comment intégrer l’IA dans une logique de sobriété, d’intelligence collective et de choix éclairés.
Le vrai danger : la pensée binaire.
L’écologie ne gagnera rien à s’opposer systématiquement aux avancées technologiques. De même que le progrès ne peut s’abstraire de toute considération éthique ou environnementale. Ce qui nous empêche aujourd’hui d’avancer sereinement, c’est cette logique binaire qui oppose les "bons" aux "mauvais", les "verts" aux "technos", les "humains" aux "machines".
Il est temps de sortir de cette opposition stérile. Apprenons à utiliser la technologie de manière générale, mais en l’occurence, les outils d’intelligence artificielle, de manière intelligente. Refusons les abus, mais refusons aussi la peur comme unique grille de lecture. L’avenir ne se construira ni dans l’aveuglement technophile, ni dans le rejet catégorique. Il se construira dans l’équilibre, la lucidité et la responsabilité.
Sentinelle Numérique 29
Dépannage système - Développement - Cybersécurité - OSINT
© 2025. Tout droits réservés